Pour en savoir un peu plus sur le génie new-yorkais, nous sommes allés à la rencontre de Laurent Dandrieu, auteur d’un livre particulièrement riche et éclairant : Woody Allen, portrait d’un antimoderne paru aux Editions du CNRS.
 LES ZEBRES MAGAZINE. – On compte déjà un certain nombre d’ouvrages consacrés à Woody Allen. Quel éclairage nouveau apportez-vous ?
LES ZEBRES MAGAZINE. – On compte déjà un certain nombre d’ouvrages consacrés à Woody Allen. Quel éclairage nouveau apportez-vous ?
Laurent Dandrieu. Il me semble que mon livre n’est pas un ouvrage de cinéma classique dans la mesure où j’ai traité Allen un peu comme s’il s’agissait d’un écrivain (et de fait, il représente un cas unique de cinéaste ayant écrit la totalité de ses films, sans jamais partir d’un matériau préexistant écrit par un autre, roman ou pièce de théâtre) : on parle beaucoup en France du cinéma d’auteur, et pour autant, parce que la critique de cinéma contemporaine est essentiellement formaliste, on s’intéresse rarement à la cohérence de la vision du monde convoyée par ces auteurs.
Il existe en effet beaucoup de livres consacrés à Woody Allen, que ce soit sur l’œuvre ou sur la biographie. Je crois néanmoins qu’il n’existait pas, en français du moins, d’essai analytique de l’œuvre qui étudie aussi complètement, de manière transversale, les grands thèmes qui courent de film en film : le pessimisme, la mort, Dieu, la morale, les femmes et l’amour, la politique, la modernité…
Et, bien sûr, comme l’indique le titre de mon livre, il me semble que l’originalité de ma lecture de cette œuvre est de placer la critique de la modernité au cœur du cinéma de Woody Allen.
En quoi le réalisateur new-yorkais est-il un antimoderne ?
Cela paraît au premier abord paradoxal, parce qu’il semble au contraire que Woody Allen, à en croire les personnages qu’il incarne à l’écran, soit l’archétype du moderne : un athée libertin, progressiste, qui a pour seule religion la psychanalyse. Et parce qu’il est, lui ou ses personnages, de plain-pied avec la modernité, on croit qu’il se confond avec elle : alors qu’il en livre au contraire une formidable satire – de l’intérieur certes, mais d’autant plus efficace ! Au fond, Woody Allen, c’est un espion du populo chez les bobos…
Philipe Muray écrivait que la modernité n’est rien d’autre qu’un interminable discours élogieux que l’époque tient sur elle-même : il est clair qu’Allen, pour qui tout était mieux avant, est en rupture complète avec ce discours d’autosatisfaction obsessionnelle : pour lui, l’époque se résume plutôt à une somme prodigieuse de ridicules, qu’il s’agisse de la crétinisation médiatique, du culte de la célébrité, du consumérisme hédoniste, du mépris des droits de l’intelligence, de la religion de la nouveauté, de la psychanalyse même, dont ses films soulignent à l’envi l’inefficacité, voire les impostures…
Au fond, la modernité a trois idoles : la raison, l’individu et le progrès. Pour Woody Allen, le seul progrès qui existe est celui qui nous conduit inexorablement vers le déclin et la mort. L’individualisme triomphant et son corollaire, le principe de plaisir, il ne cesse d’en dénoncer les méfaits – notamment dans les relations amoureuses – dans ses films, qui font au contraire l’éloge du principe de responsabilité et de la conscience morale. Quant à la raison, il moque continument son dévoiement par la modernité quand, coupée de l’intelligence du cœur, la raison devenue rationalisme devient un intellectualisme étroit et risible : voir notamment le personnage grotesque de Leopold dans Comédie érotique d’une nuit d’été, savant ivre de son intelligence jusqu’au plus total aveuglement.
Et puis, il y a la question de Dieu…
Pour le moderne, il n’y a pas de plus grande libération que la mort de Dieu. J’ai voulu montrer que pour Woody Allen, au contraire, la mort de Dieu n’est pas une certitude mais une simple hypothèse, et une hypothèse catastrophique. Parce que si Dieu n’existe pas, non seulement il est difficile de trouver un plombier le week-end, non seulement il n’y a pas d’au-delà (« idée déprimante, surtout si on a pris la peine de se raser »), mais il est presque impossible pour les hommes d’avoir un comportement moral décent, et donc de vivre ensemble harmonieusement.
D’où vient son obsession pour la mort ?
Woody Allen raconte lui-même qu’enfant, il a soudainement pris conscience que l’univers n’était pas éternel et que ça a causé chez lui une forme de dépression. Chez lui, l’idée qu’une vie puisse basculer dans le néant, qu’il n’y ait même pas d’immortalité garantie par l’œuvre, puisque même Bach et Shakespeare disparaîtront un jour, est une formidable ombre portée qui pèse sur chaque minute de l’existence, qui en gâte la saveur d’une inépuisable nuance d’amertume. Ce désespoir de ne pas se survivre, c’est le revers d’une aspiration à l’infini qui est solidement plantée dans le cœur de tout homme – même si beaucoup la font taire –, à laquelle les chrétiens, par exemple, répondent par la vertu d’espérance, mais qui pour les incroyants peut devenir un perpétuel tourment. Mais il est clair que chez Woody Allen, cette angoisse de la mort est le symptôme d’une inquiétude métaphysique.
Pourquoi, selon vous, séduit-il autant les bourgeois et les intellectuels alors même qu’il s’en moque à longueur de scénarios ?
Les plus lucides, à l’évidence, l’apprécient justement parce qu’ils croient avec Molière que la vertu de la comédie est de corriger les vices des hommes, et pas seulement la paille qui est dans l’œil du voisin : le cinéma est avant tout un miroir qui nous permet de regarder nos propres vies avec plus de lucidité. D’autres, sans doute, trompés par le fait que Woody partage le mode de vie des personnages qu’il satirise, réduisent son œuvre à son aspect burlesque en minimisant sa dimension satirique…
Vous n’êtes pas particulièrement tendre avec ses derniers films… Pensez-vous que le vieux Woody ait encore des choses à nous dire ?
Il est vrai qu’à l’exception de Minuit à Paris, qui était une fantaisie plaisante sans égaler les chefs d’œuvre d’autrefois, les cinq derniers films d’Allen donnent le sentiment d’un épuisement de l’inspiration et de l’installation du cinéaste dans une certaine paresse routinière. Sans doute le moteur de sa créativité a-t-il toujours été une forme d’angoisse, d’intranquillité – or il semble qu’aujourd’hui Allen – tant mieux pour lui, tant pis pour nous ? – soit devenu plus serein. Cela étant dit, il ne faut jamais désespérer du génie, et le cinéaste a connu d’autres périodes creuses, avant de renaître de ses cendres : en 2004, par exemple, en voyant Melinda et Melinda, on pouvait se demander où était passé Woody Allen. L’année suivante, il nous donnait Match Point.
Quel est, de votre point de vue, son film le plus abouti, celui qui restera plus que les autres ?
Difficile d’en choisir un, en laissant de côté des films aussi magnifiques qu’Annie Hall, Zelig, Hannah et ses sœurs, Crimes et délits… Aujourd’hui, j’ai pourtant envie de vous répondre La rose pourpre du Caire, parce que c’est une somptueuse fable sur la puissance du rêve, sa capacité à nous consoler d’une réalité forcément décevante, qui me paraît symptomatique du pessimisme constructif d’Allen, un pessimisme qui refuse de désespérer jusqu’au bout et de fermer définitivement la porte à une forme d’espérance.
Justement, si Woody Allen sortait de l’écran comme le Tom Baxter de La rose pourpre du Caire et que vous pouviez lui poser une seule question, que lui-demanderiez-vous ?
J’hésiterais entre « Y a-t-il une vie avant la mort ? » et « Pourriez-vous me passer le numéro de téléphone de Scarlett Johansson ? »
Propos recueillis par Benjamin Pechmezac
Woody Allen, portrait d’un antimoderne, par Laurent Dandrieu, CNRS éditions, collection Biblis, 306 p., 10 €.

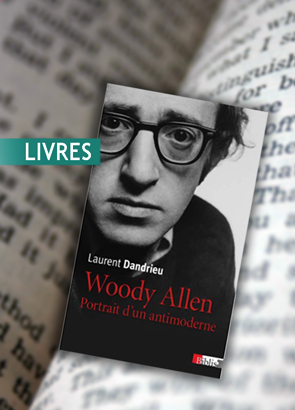
One Reply to “ENTRETIEN// Laurent Dandrieu, auteur du livre « Woody Allen, portrait d’un antimoderne »”
Comments are closed.